Critiques en vrac un peu particulier ce mois-ci puisqu’entièrement consacré à 2 grands cinéastes issus de notre cher Europe dont je me suis fait/refait un certain nombre de films ce mois-ci.
Dario Argento : le génie, l’arnaque ou le génie de l’arnaque ?

Disons le net, je ne suis pas un grand fan de Dario Argento. Malgré mon affection pour le cinéma d’horreur, j’ai toujours eu du mal à appréhender les œuvres de ce maître de l’épouvante. J’ai même de graves difficultés à rester calme face à la prétention du bonhomme, méprisant le travail d’écriture et s’exclamant à longueur de pellicule “ma caméra se suffit à elle-même !”. Cette approche qui revendique un rejet des conventions sous le prétexte qu’il vaut mieux que ça m’échauffe les nerfs au plus haut point. Mais bon, son cinéma dit “de séquences” est au moins agréable à suivre de par ses évidentes qualités visuelles et j’espère toujours retomber sur un opus à la mesure de profondo rosso, seule œuvre d’Argento que je tiens en très haute estime. Profitant de la sortie groupée effectuée par Wild Side il y a quelques mois, je me suis dit qu’il était temps d’essayer de trouver satisfaction dans les œuvres les plus essentiels du bonhomme.
Ténèbres (1982)

C’est donc avec plein d’espoir que je me suis aventuré vers ténèbres... pour en ressortir avec une impression d’œuvre sympathique mais loin d’être à la mesure de sa réputation. Je me souviens que dans le long documentaire sur le dvd collector de profondo rosso, Argento définissait ténèbres comme un cri de colère et une certain attaque envers la critique (Vous croyez que je fais uniquement des films d’horreur pornographiques pour psychopathe ? Ben je vais vous montrer ce que c’est qu’un vrai film d’horreur pornographique pour psychopathe !). Une ambition qui annonçait une œuvre enchaînant à la pelle les excès horrifiques propices à rendre plus acceptable une structure en saynète. Double désappointement, ténèbres n’a plus grand-chose de bien choquant (la séquence à la Pollock est fabuleuse mais le reste n’offre rien de bien exceptionnel graphiquement) et déroule une trame assez classique en dépit de tout ce que le film peut avoir de nouveau chez Argento (utilisation de l’architecture moderne, photographie lunaire délaissant toutes zones d’ombre). Même la mise en scène ne me semble pas toujours à la mesure de ce qu’elle est censée offrir entraînant à mon sens un décalage avec la génial BO complètement déchaînée pour sa part. Il y a énormément d’idées brillantes mais je trouve que l’imagerie s’en dégageant n’a pas l’impact escompté. Je classe tout particulièrement là-dedans le célèbre plan à la louma. J’avais vu les images de tournage et j’avais été très impressionné par le dispositif. A l’écran, on récolte essentiellement un long gros plan sur du béton et des tuiles et on ne sent aucunement l’amplitude du mouvement.
Là où le film marque des points à mes yeux c’est de par le télescopage du réalisateur avec son personnage principal. La perspective donne énormément de poids au film et le rend très savoureux par moment (la citation du chien des Baskerville qui résume toute sa carrière cinématographique). Et le final est d’ailleurs fortiche pour désarçonner le spectateur. J’adore d’ailleurs cette idée pour mettre à mort le tueur. Malgré l’ingéniosité de la mécanique qu’il a mis en place, celui-ci va mourir de manière incongrue empalé sur une statue. Chez Argento, la plus huilée des narrations ne peut décidément rien face à la toute puissance esthétique. J’apprécie également l’ouverture montrant le tueur lire tranquillement le roman au coin du feu. Ce feu est illustré comme sa pulsion meurtrière qui bouillonne au fond de lui et qui ne demande qu’à sortir. Au bout du compte, le tueur jette le roman dans le feu ce qui attise les flammes. C’est une très belle illustration d’une idée que Craven ne saura faire passer qu’à travers une réplique dans son scream : les films ne créent pas de psychopathes mais les rend plus inventifs. Ce genre de passage arrive à me faire convaincre que j’ai passé un bon moment mais ça ne me fera définitivement pas considérer Argento comme un génie du genre.
Mother of tears (2007)

Comment ça j’ai dit que je me concentrerais sur les œuvres essentielles d’Argento ? Vu que je suis pas du genre à tenir mes promesses, je n’ai pas pu m’empêcher de jeter un œil sur ce si conspué mother of tears. Vu la réputation du film, je m’attendais à quelque chose de magique. Et effectivement, c’est une fabuleuse contre-performance que nous livre Argento. L’objet est fort étrange tant il ne laisse jamais le spectateur s’habituer à ce qu’il voit. Le film change en effet régulièrement de ton comme si il ne savait pas sur quel pied danser. En relisant le HS Mad sorti récemment, il y était dit que le budget a été considérable réduit à la veille des prises de vue et que Argento a du remanier son script en plein tournage. Cela expliquerait l’aspect polyvalent du film. Ça commence ainsi plutôt bien. Bon Argento force toujours le trait pour plier l’histoires à ses envies filmiques mais le bonhomme sait encore plutôt bien tenir sa caméra (faut quand même supporter l’immonde photographie) et la musique de Claudio Simonetti avec ses chœurs perpétuels est assez sympa. Puis vient le premier meurtre et là on se dit qu’Argento il a peur de rien. Une pauvre demoiselle va ainsi connaître une quadruple mise à mort. Elle va ainsi se faire démonter la mâchoire, éventrer, étrangler avec ses propres entrailles et finalement dévorer par des monstres de carnaval. Un empilage d’atrocité chargeant la mule et tellement desservi par des maquillages ridicules qu’on s’en amuse plus qu’on ne s’en effraie. Mother of tears semble donc parti vers un rigolo déchaînement de violence zarbi.
Ben finalement non. Par la suite, on passe un nouveau palier et Argento nous offre avec joie de grandes discussions fascinantes dignes d’un téléfilm FR3. Un train-train aussi ronflant qu’incohérent semble se mettre en place et puis boum Argento nous balance sa vision du fantastique dernière manière. Là il nous offre les apparitions impayables de Daria Nicolodi et réduit à néant une mythologie ambitieuse par une illustration poussive à souhait. Difficile en effet de prendre au sérieux la menace du film constituée par une bande de sorcières incarnée à l’écran par une tripotée de biatch mal fringuées qui passent leur temps à rigoler bêtement. Un choix effarant de débilité qui peut difficilement être justifié par l’argument du manque de moyen. Celui-ci peut toutefois bien être invoqué pour la représentation du chaos dans lequel est censé plonger Rome. Avec des possibilités limitées, l’horreur à grande échelle sous l’œil du cinéaste ne devient plus que quelques exactions éparses interprétées sans conviction par de pauvres figurants (2 mecs détruisent une voiture : le monde est vraiment proche de la fin) et mis en boîte de manière rocambolesque (mention au meurtre du bébé). Mother of tears ressemble au bout du compte à un incroyable accident de la route : c’est stupide, abominable à voir et pourtant fascinant. Il a au moins ça pour lui.
Le chat à neuf queues (1971)

A la base, l’étape suivante de ma rétrospective devait être trauma. Vu sa réputation, je me suis dit que ça aurait été sûrement un peu trop douloureux après mother of tears. Je me suis donc rabattu sur le chat à 9 queues. Et quelle belle surprise que ce deuxième long du bonhomme ! C’est en tout cas la preuve inéluctable que les jeunes cinéastes font toujours des maladresses sur leurs premières œuvres qu’ils tenteront d’expurger par la suite. Ben oui parce qu’avec le chat à 9 queues, Argento va nous raconter une histoire. Roohhh quelle connerie il a fait là ! Blague à part, j’ai justement été séduit par la certaine retenue du film. Il est assez logique qu’Argento se soit éloigné du film qualifiant sa recette de “trop américaine”. C’est justement par cet aspect que le film est intéressant. Le chat à 9 queues prend finalement le meilleur des deux mondes. D’un côté, on a la rigueur hollywoodienne avec une intrigue tenant la route où se construisent mystère et suspense. De l’autre, il y a le formalisme génial d’Argento. Il aligne ainsi les cadrages soignés, les mouvements de caméra brillants et autres vues subjectives immersives mais ne tombe pas pour autant dans le piège de “l’esthétisme pour l’esthétisme”. Ses effets servent toujours le déroulement du récit permettant d’aboutir à un divertissement de fort belle tenue. Le film souffre quand même de quelques coups de mou et certaines idées ne sont pas aussi charmantes qu’elles devraient l’être (l’atypique tandem principal composé d’un journaliste et d’un aveugle manque un peu de synergies) mais c’est quand même un beau boulot efficace et carré qui ne trahit pas particulièrement les obsessions de son auteur (la perception de l’environnement cinématographique par les personnages et le spectateur a toujours autant d’importance). Peut-être pas aussi marquant et définitif qu’un profondo rosso, le chat à 9 queues se place néanmoins sans problème dans le haut du panier de la filmographie d’Argento à mes yeux.
L’oiseau au plumage de cristal (1970)

Galvanisé par la découverte du chat à neuf queues, je me suis plongé avec beaucoup d’enthousiasme dans cet oiseau au plumage de cristal. Trop d’enthousiasme et j’ai eu la désagréable impression que ce premier film d’Argento ne vole pas sa réputation d’œuvre matricielle : il contient tout ce qui me bloque chez le bonhomme. Je comprends cela dit un peu mieux pourquoi Argento a plus ou moins désavoué le chat à neuf queues et préfère exprimer son affection pour l’oiseau au plumage de cristal. Le chat à 9 queues était efficace, carré et d’un professionnalisme complet. En bref, un enfer pour quelqu’un comme Argento chez qui tout doit être imprévisible et le récit fluctuant selon ses appétits. L’oiseau au plumage de cristal dévoile plus volontiers la fibre artistique du bonhomme et donc ses partis pris qui n’ont guère mes faveurs. L’intrigue joue donc sans complexe sur l’improbabilité de ses situations et un certain libertinage narratif. Argento se désintéresse de l’enquête policière et la triture au profit de ses scènes chocs souvent incongrus. Cela peut conduire à offrir des passages puissants (le meurtre d’ouverture et les tentatives pour la décrypter) et d’autres plus risibles que terrifiantes (le tueur bloqué au seuil de la porte de sa victime commet l’ultime outrage en y creusant un trou : mais quelle ordure quand même !). Reste heureusement que malgré des artifices parfois rudimentaires (mais naturel pour un premier long), le film fait preuve d’une maîtrise cinématographique toujours alléchante avec des idées brillantes à foison. Mais bon, c’est quand une déconvenue en bout de course.
Trauma (1993)

Le voilà donc le si redouté trauma. L’infâme trauma, l’inexcusable trauma, l’involontairement drôle trauma, le foireux trauma ou encore l’embarrassant trauma comme on aime à dire. Mais pourquoi tant de haine, ai-je envi de dire ? Je trouve que cette œuvre si décriée a des atouts pour se défendre. Le point principal reste à mes yeux une toujours aussi évidente maîtrise cinématographique. Le premier meurtre m’a d’ailleurs bien mit en confiance. Idées de cadrages brillantes, photographie travaillée (même si l’esthétisme évoque plus un Brian de Palma que du Argento pur jus) et usage alléchant de la steadicam sont au rendez-vous pour une scène classique du genre mais rondement mené. Bon après, je ne peux que reconnaître que je désenchante face à la première rencontre des deux personnages principaux dont l’absurdité totale est sidérante. D’après ce que j’ai lu (toujours dans le HS de Mad), il s’agit là d’une des scènes qui aurait été retourné suite à une politique de remontage du film. Déjà bien mis à mal par des réécritures inopportunes (vu la matière à disposition et la manière dont en parle les intéressés je suis convaincu que les premières montures du script auraient pu donner un excellent film), trauma prend l’eau. La manière dont Argento filme la rencontre est d’ailleurs équivoque quant au détachement dont il fait preuve. Plutôt que de concentrer sa caméra sur les comédiens, il préfère composait un large (et beau) plan sur le pont dans lequel les acteurs n’ont plus qu’une place accessoire. Pas mal d’idées de ce genre reviennent au gré du film, notamment avec cet étonnant travelling lors du générique de fin (effet gratuit conduisant à une bonne blague). En soit, je me montre indulgent face à une œuvre à la conception si douloureuse et qui fut tellement trituré qu’elle présente des plaies béantes dans lesquelles le spectateur ne peut que tomber. Le film est monté à la serpe (Argento aime les transitions brutales mais là c’est d’une stupidité qui dévoile clairement des coupes), manque de gore (même si il en montre assez sur ce point pour me convaincre) et n’arrive pas à atteindre le degré émotionnel désiré (difficile de s’attacher au couple principal, surtout vu la qualité de l’interprétation). Mais trauma reste porté par les vastes attirails de mise en scène chers à son auteur et surtout par une indéfectible volonté de porter son histoire. Vu que généralement Argento fait l’inverse, je ne peux qu’exprimer ma sympathie face à la démarche aussi boiteuse soit-elle.
Inferno (1980)

Malgré les difficultés que j’ai eu devant le visionnage de suspiria, j’étais assez enthousiaste à l’idée de découvrir un inferno depuis si longtemps inaccessible dans nos contrées. Sans surprise, le film tient effectivement beaucoup à son visuel. C’est un éblouissement de tous les instants. Les décors élaborés sont magnifiques, la photographie avec ses jeux de couleurs est sublime, la mise en scène en jettent plein la gueule et certains plans sont complètement incroyables (l’apparition de la mort). Toutefois, bien qu’il soit considéré comme une des œuvres d’Argento où le scénario est le plus en retrait (on le compare souvent à un opéra), je n’ai pas trouvé celui-ci si catégorique au regard de l’évolution du récit. Suspiriamettait en scène un personnage principal qui était appelé à mener son enquête sur certains évènements. Cela devrait logiquement donner une intrigue linéaire mais celle-ci ne convient aucunement à Argento. Dans inferno, on a au contraire plusieurs personnages qui mènent la danse. Chaque personnage amasse des informations et refile le bébé à quelqu’un d’autre qui est chargé de poursuivre l’intrigue. Cela donne une sorte de structure narrative avec une spirale en pointillé où au fil de l’avancée des personnages, on sent qu’on approche du centre du mystère bien que ceux-ci n’en aient qu’une vision fragmentaire. Cela offre d’ailleurs la certaine originalité d’un personnage principal qui traverse l’histoire sans en comprendre un traître mot. Dommage que la structure intriguant dans la première moitié s’essouffle dans la deuxième. Il faut dire que les défauts finissent par s’agglutiner entre un acteur principal qui est une vraie loque (c’est censé servir le personnage mais c’est juste insupportable), une musique merdique (le classique ça va mais la composition originale est horrible et le sympathique thème est utilisé n’importe comment) et quelques scènes ratées (l’attaque des chats absolument pas convaincante là où celle des rats est franchement éprouvante). L’expérience demeure néanmoins très attachante et a le mérite de m’avoir donné envi de rejeter un œil à suspiria. Voilà qui fera un bon début pour ma prochaine plongée dans la galaxie Argento.
Renny Harlin : le bourrinage est un art de vivre

Harlin aura quand même bien réussit son coup. Le bonhomme aura tellement réussit à s’intégrer dans l’industrie cinématographique américaine que tout le monde semble oublier qu’il est finlandais d’origine. Du coup, c’est sans honte que je peux lui apposer la caution auteur européen et me lancer dans une rétrospective de son œuvre. Oui bon, c’est vrai aussi que je me foule pas parce qu’avec Harlin, le décryptage thématique y tient pas à grand chose.
12 rounds (2009)

Voilà le film qui m’a poussé à faire une rétro sur le bonhomme. Parce que 12 rounds m’a rendu triste, très triste. En le voyant, je me dis que le si attachant Renny Harlin est entré dans une nouvelle phase. Depuis une décennie et le bide cumulé l’île aux pirates/au revoir à jamais, Harlin était rentré dans une forme de pétage de plomb. Déjà peu porté sur la subtilité et prenant plaisir à verser dans l’action rentre-dedans dont personne ne se plaindra, Harlin avait complètement largué les amarres en découvrant les possibilités des CGI. Cela a donné plusieurs films complètement ahurissants où il utilisait les pires techniques numériques pour mettre en boîte ses idées dégénérées. Puis ces dernières années, j’ai l’impression qu’Harlin commence un douloureux retour sur terre. C’est comme si il avait compris qu’il n’était plus in et qu’il s’est tellement grillé auprès des studios (et du public en général) qu’il ne risque plus de toucher à un de ces gros budgets sur lesquels il pourrait assouvir pleinement sa passion de l’art bourrin. Parce qu’il faut se rendre à l’évidence : si 12 rounds n’a eu droit qu’à une exploitation express en salle, c’est parce qu’il ne méritait pas plus. En le projetant sur un écran de cinéma, on serait immédiatement saisi par la pauvreté des moyens à disposition. Rien qu’un écran 16/9 de taille convenable montre les limites budgétaires de la chose. Aussi alléchant soit le pitch (un adepte des pièges saw-esque lance un Matt Damon sous testostérone dans une série de travaux herculéens), le film souffre d’un tel manque d’ampleur et de spectaculaire qu’on ne suit l’ensemble qu’avec un ennui poli. Le film aurait besoin de scènes d’action imposantes pour gonfler d’adrénaline son spectateur mais elle n’en a pas les moyens. Harlin tente de faire illusion en s’amusant avec les maigres jouets à disposition (vlan le camion de pompier, baf le tram, boum l’hélicoptère) mais son emballage à la Tony Scott du pauvre n’arrive pas à masquer son manque de motivation face à la pauvreté de la production à disposition. En voyant Harlin tombési bas, j’aurais presque envi de pleurer mais bon, nous ses fans on est pas des tapettes.
Au revoir à jamais (1996)

Pour oublier le désenchantement de 12 rounds, rien de mieux qu’un retour sur ce qu’on peut aisément considérer comme le dernier vrai bon film du bonhomme. En soit, l’objet est d’autant plus attachant qu’il est également le dernier travail du scénariste Shane Black avant une mise en veille de pratiquement 10 ans. Revoir the long kiss goodnight est d’ailleurs un excellent moyen de reconsidérer tout son talent. Le premier point tient bien sûr au personnage principal. Je m’étais toujours arrêté à son côté femme couillue mais le film arrive à mettre en avant un portrait plus complexe par rapport à la dualité de son personnage (merveilleusement incarné par Geena Davis). Le film n’aurait sûrement pas eu le même impact si le personnage avait été un homme, le caractère féminin apportant une sensibilité plus forte notamment au regard de la thématique sur la maternité. C’est un des aspects forts intéressants du film auquel se rajoute un désamorçage heureux de moult clichés (pas de véritable romance entre les deux personnages principaux, pas de retournement de situation par rapport à la découverte de la paternité de la gamine), des répliques qui claquent (le personnage de Brian Cox, c’est rien que du bonheur... dommage qu’il disparaisse si rapidement) et une structure à la solidité exemplaire (les petits détails introduis à l’avance pour justifier le déroulement de l’action). Pas étonnant qu’outre l’envi de mettre en valeur sa femme, Harlin se soit focalisé sur un tel script pour se reconstruire suite au bide massif de l’île aux pirates. Il offre d’ailleurs le meilleur de lui-même avec une mise en scène carrée et très efficace dopée par la photographie fort appréciable de Guillermo Navarro (le sauvetage de Samuel L. Jackson après la renaissance de l’héroïne me paraît toujours aussi puissant grâce à ses éclairages). Toutefois malgré le sérieux dont il fait preuve, on le sent déjà parfois à 2 doigts de tomber dans la folie filmique que ce soit avec les SFX (les incrustations pour l’explosion finale) ou certaines idées (la version alternative présentée sur le DVD du meurtre sur glace est juste hilarante). Dommage que l’échec au box-office l’ait conduit à franchir le pas pour ses projets suivants. Nul doute que si ce fort sympathique divertissement avait eu du succès, la suite de la carrière d’Harlin aurait été toute autre.
Cliffhanger (1993)

En le revoyant, je me dis que cliffhanger est la parfaite démonstration de l’art du bourrinage made in Harlin. En effet, l’histoire offre une base assez porteuse avec cette histoire d’affrontement en montagne. Il y a une ironie par rapport à un enjeu (retrouver des valises pleines de biftons avant l’équipe adverse) assez risible au regard de l’environnement naturel qui l’entoure (l’argent compte apparemment plus que la survie pour la plupart des personnages). Un McTiernan n’aurait pas manqué d’exploiter ce ressort narratif. Sauf que c’est pas John aux commandes mais Renny. L’idée attrayante, il l’a gicle en une réplique (“comment on s’enfuit de cette montage même avec du fric ?” déclare un des personnages) et il se concentre sur son étalage d’action et de violence. Cliffhanger devient donc un énorme missile lancé à toute berzingue qui détruit tout sur son passage et ne s’arrête pas sur les détails. C’est l’exemple même de ce si regretté divertissement 90’s où on ne laissait pas 5 minutes s’écouler sans balancer une baston, une fusillade ou une catastrophe en tout genre. En résulte un captivant divertissement sous pression qui pour ne rien gâcher se montre une brillante démonstration de savoir-faire (mise en scène ultra-efficace, joli cinémascope, musique brillante, bon castingde tronche). Le seul truc qui me gène, c’est que je me suis rendu compte à la revoyure que le film contient un certain lot de trucages pas heureux. Il y a bien plein d’incroyables cascades dans le film mais j’ai été désappointé en y rejetant un œil de découvrir qu’un certain nombre de scènes puait le tournage en studio. J’aurais presqueété déçu par ce côté mythe qui s’effondre (je restais persuader jusqu’à présent que le film avait été quasi-intégralement tourné dans des décors naturels) si cliffhanger ne restait pas une œuvre tellement addictive que défauts et qualités s’assimilent avec le même plaisir.
Peur bleue (1999)

Peur bleue est donc le film qui a vu la naissance du Harlin version 2.0. En même temps, faut le comprendre. Il tente une réactualisation du grand film d’aventures avec plein d’humour et d’action, il se vautre lamentablement la gueule au box-office. Il essaie de livrer un film d’action avec un minimum de profondeur, rebelote. Pas étonnant qu’il en ait marre. Peur bleue aurait pu ainsi être une démonstration pour faire croire qu’il est encore dans le coup. Si il en a l’apparence, il ressemble plus à un gros fuck craché au monde. Il y a un temps il aurait peut-être tenté de faire tenir debout ce jaws à la sauce film catastrophe. Mais maintenant, il en a rien à foutre et il compose n’importe comment avec les ingrédients à disposition. J’ose d’ailleurs toujours pas croire qu’il ait osé dire qu’il était impossible de distinguer les vrais requins des faux. Mais bon, ses animatroniques impressionnants mais fleurant bon le caoutchouc et ses CGI tous pourries font le charme d’une production à la perversité réjouissante. Harlin semble ainsi prendre son pied avec le concept du film catastrophe où les mises à mort doivent valoir lieu d’expiation divine : croquer la main du scientifique qui tenait une cigarette, engloutit le perroquet qui jure à longueur de scène, écarteler ce salopard de millionnaire qui se la ramène avec sa morale à la con, dévorer par l’entrejambe la blondasse (dont on apprend dans une scène coupée qu’elle attend un bébé hors mariage) et, plus fort que tout, gober d’un coup l’héroïne responsable de tout ce bordel. Harlinn’affiche même pas deux secondes de scrupules et annihile en deux temps trois mouvements toutes possibilités d’une fin heureuse avec bisou devant un lever de soleil. Une caution morale complètement grotesque qui participe au côté déviant de l’entreprise. Harlin y se fout de tout et nous aussi. Du coup, c’est sans honte qu’on peut savourer une œuvre délirante où l’exagération (Thomas Jane qui passe tout le film à faire son intéressant, sa panoplie allant de la glissade dans 2 centimètres d’eau au rodéo à dos de requin) et le portnawak (LL Cool J en cuistot intégriste qui a un gros bâton) deviennent carrément de la virtuosité. Un fabuleux plaisir coupable en somme comme peut l’être considéré driven, dernier film de ma rétrospective Harlin qui aura droit à une critique à part pour finir en beauté.


















 5 cm par seconde de Shinkai Makoto
5 cm par seconde de Shinkai Makoto Hyper tension 2 de Mark Neveldine et Brian Taylor
Hyper tension 2 de Mark Neveldine et Brian Taylor L’autre de Robert Mulligan
L’autre de Robert Mulligan Fantasia 2000 de Roy Disney
Fantasia 2000 de Roy Disney Au-delà de Clint Eastwood
Au-delà de Clint Eastwood Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi
Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi The green hornet de Michel Gondry
The green hornet de Michel Gondry Les chemins de la liberté de Peter Weir
Les chemins de la liberté de Peter Weir Tygra, le feu et la glace de Ralph Bakshi
Tygra, le feu et la glace de Ralph Bakshi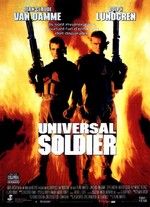 Universal soldier de Roland Emmerich
Universal soldier de Roland Emmerich Titre original : Tron legacy
Titre original : Tron legacy



 Titre original : Tron
Titre original : Tron



 Tous les matins du monde de Alain Corneau
Tous les matins du monde de Alain Corneau Fantasia de Walt Disney (okay il est pas le réalisateur mais c’est tout comme)
Fantasia de Walt Disney (okay il est pas le réalisateur mais c’est tout comme) Le lac des morts-vivants de Jean Rollin
Le lac des morts-vivants de Jean Rollin Le dragon du lac de feu de Matthew Robbins
Le dragon du lac de feu de Matthew Robbins Scott Pilgrim vs the world d’Edgar Wright
Scott Pilgrim vs the world d’Edgar Wright Le passager de la pluie de René Clément
Le passager de la pluie de René Clément Les disciples de la 36ème chambre de Chia-Liang Lu
Les disciples de la 36ème chambre de Chia-Liang Lu Ladyhawke de Richard Donner
Ladyhawke de Richard Donner Bartok le magnifique de Don Bluth et Gary Goldman
Bartok le magnifique de Don Bluth et Gary Goldman The tourist de Florian Henckel Von Donnersmarck
The tourist de Florian Henckel Von Donnersmarck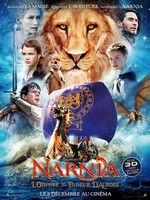 Le monde de Narnia : l’odyssée du passeur d’aurore de Michael Apted
Le monde de Narnia : l’odyssée du passeur d’aurore de Michael Apted Poltergeist 2 de Brian Gibson
Poltergeist 2 de Brian Gibson



















 Titre original : Tarzan
Titre original : Tarzan


 Titre original : the lost world
Titre original : the lost world


 Sunshine d’Istvan Szabo
Sunshine d’Istvan Szabo Incidents de parcours de George Romero
Incidents de parcours de George Romero Le parrain 2 de Francis Ford Coppola
Le parrain 2 de Francis Ford Coppola Horus, prince du soleil d’Isao Takahata
Horus, prince du soleil d’Isao Takahata Un faux mouvement de Carl Franklin
Un faux mouvement de Carl Franklin Buried de Rodrigo Cortès
Buried de Rodrigo Cortès Harry Potter et les reliques de la mort – 1er partie de David Yates
Harry Potter et les reliques de la mort – 1er partie de David Yates Get Carter de Stephen Kay
Get Carter de Stephen Kay Aladdin et le roi des voleurs de Tad Stones
Aladdin et le roi des voleurs de Tad Stones Unstoppable de Tony Scott
Unstoppable de Tony Scott/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F6%2F6%2F660522.jpg)